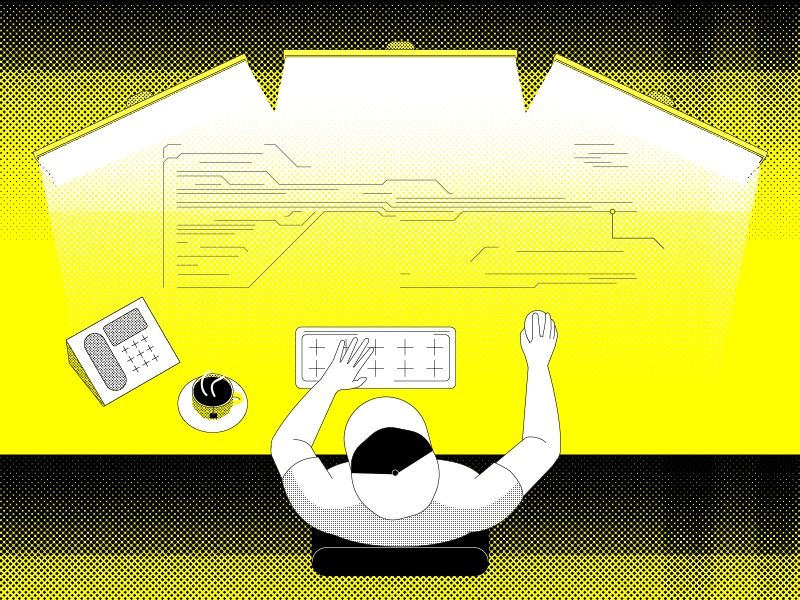Il est chercheur à l’emlyon business school, docteur en comportement organisationnel et professeur agrégé. Il coache de nombreux dirigeants et cadres sur des problématiques de management et d’épanouissement au travail. La question du sentiment de justice ou d’injustice, reste plus que jamais au cœur des relations humaines et de la réussite collective des entreprises.
Pourquoi ce nouveau livre sur « Le management juste ? »
Thierry Nadisic : Aujourd’hui, dans le monde de l’entreprise, on entend de plus en plus de questionnements du type : Mon manager me donne-t-il la possibilité de m’exprimer avant de prendre une décision ? Fait-il preuve d’empathie et de soutien émotionnel ? Communique-t-il avec clarté ? Les recherches actuelles montrent que ce sont ces questions, plus que celles de l’équité de notre rémunération, qui nous permettent d’évaluer si nous sommes traités de façon juste.
Ce sentiment de justice répond à nos besoins les plus fondamentaux de reconnaissance sociale et de maîtrise de l’incertitude, ce qui en fait l’une des principales sources du bien-être et de l’engagement au travail. J’ai voulu démontrer dans ce livre que l’engagement et le bien-être dépendent davantage de la manière dont le manager décide et informe que de la décision elle-même.
Avec vos travaux, vous participez au développement de pratiques de management plus vertueuses et plus épanouissantes. En quoi
ces pratiques sont au cœur d’un nouveau modèle d’entreprises ?
Je ne suis pas sûr qu’il y ait véritablement un nouveau modèle d’entreprises. Ce que je sais en revanche c’est que de nouvelles pratiques émergent. Nous sommes en plein coeur de la troisième révolution industrielle avec énormément de bouleversement technologiques, mais aussi de profonds changements sociétaux.
Cette mutation est en train de remettre en question de nombreux schémas existants et il est donc normal que le monde de l’entreprise soit aussi touché par ces transformations qui remettent en question des notions comme le patriarcat ou l’autorité hiérarchique, et qui font émerger de nouvelles pratiques managériales. L’entreprise
s’est transformée et avec elle les relations humaines entre dirigeants, managers et salariés. Nous avons connu par le passé le modèle Taylorien-Fordien qui a révolutionné l’organisation des entreprises, ce qui a permis les Trente Glorieuses et a débouché sur une production de masse. Ce modèle a changé et on voit aujourd’hui l’émergence de plein de modèles différents. D’un côté, on voit apparaître des modèles d’entreprises à la fois bienveillantes et plus éthiques et de l’autre des modèles plus rigides et plus autoritaires.
En quoi le sentiment de justice ou d’injustice au travail, au cœur de votre dernier ouvrage, a-t-il des conséquences sur l’entreprise, mais aussi sur ses dirigeants, ses managers et ses salariés ?
Quand on donne des ordres à ses salariés, on produit de l’obéissance. Quand on leur donne du pouvoir d’agir, de l’autonomie, des possibilités d’initiatives, quand on leur permet d’accéder à leurs ressources intérieures, on produit alors de l’engagement. Aujourd’hui, le fait que l’autorité soit moins légitime, entraîne que lorsqu’un patron vous donne un ordre, ça ne vous motive pas,
vous allez faire le minimum. Si a contrario, le patron vous fait participer voire vous délègue et partage avec vous ses décisions, vous allez vous engager à ses côtés. Des études démontrent que des salariés qui se trouvent injustement traités et managés, font des pauses plus longues, sont plus souvent en arrêt maladie, ne rangent pas l’atelier et vont même jusqu’à voler des produits de l’entreprise. Ce qui au final coûte cher à la société à tous points de vue. Un salarié injustement traité ne sera pas souvent en résistance car il ne veut pas se mettre en danger, il choisira plutôt de saboter les choses de manière invisible.
Les réseaux sociaux ne participent- ils pas à cette démultiplication du sentiment général d’injustice ?
Oui, absolument. Le sentiment d’injustice a pris plus d’importance aujourd’hui et il trouve un plus large écho avec internet et les réseaux sociaux. Le changement principal, c’est la remise en cause de l’autorité qui a une forte résonance émotionnelle. Un fort sentiment d’injustice produit de la colère, de la peur, parfois de la honte, du dégoût et même de la surprise. Autant d’émotions qui sont contagieuses et qui prennent de la force avec les réseaux sociaux qui leur donnent encore plus d’importance.
C’est quoi le sentiment d’injustice en entreprise ?
L’injustice, c’est ce que les personnes au travail ressentent de manière subjective, mais sur la base d’antécédents objectifs. Il y en a quatre types. Au premier étage, il y a ce que l’on appelle l’injustice distributive, c’est-à-dire en d’autres termes ne pas recevoir sa part du gâteau, ne pas être rémunéré à sa juste valeur. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas celle qui a le plus d’importance pour les personnes, sauf pour les plus bas salaires.
Deuxièmement, l’injustice procédurale, c’est-à-dire le sentiment que la manière dont les décisions sont prises est juste ou pas. Par exemple, un nouveau poste est en cours de recrutement. Vous postulez et vous n’êtes pas reçu en entretien, puis vous apprenez que c’est un ami du directeur qui a été engagé. C’est le sentiment que la décision est biaisée qui entraîne donc une perte de confiance et donc le sentiment d’injustice.
Le troisième étage est celui de l’injustice interpersonnelle, c’est-à-dire ce qui se passe dans la relation à l’autre. C’est le cas si vous avez le sentiment d’être traité comme un invisible ou un moins que rien. Si l’entreprise demande au salarié une qualité de service au client, il demandera à être traité avec la même qualité par son manager, c’est ce que l’on appelle la symétrie des attentes. C’est d’ailleurs devenu un enjeu stratégique pour les entreprises.
Et enfin, quatrièmement, on parle d’injustice informationnelle, c’est- à-dire le fait de donner l’information sur les décisions prises en amont et en aval. Les salariés ont besoin de transparence, et encore plus si l’entreprise traverse une situation de crise.
A partir de là, comment définir et mettre en place un « management juste » ?
L’idéal bien entendu serait de pratiquer à la fois la justice distributive, procédurale, interpersonnelle et informationnelle. Mais c’est très rare que les entreprises arrivent à être parfaitement justes sur ces quatre dimensions, à ces quatre étages. Ce qui compte, c’est qu’il y ait des compensations. Par exemple, si de nombreux salariés pensent être injustement traités sur le plan de la distribution, c’est-à-dire de leur rémunération, ils peuvent cependant s’engager fortement dans leur travail, s’ils ont le sentiment d’être justement traités aux trois autres étages.
A l’inverse, ils auront envie de démissionner, de trouver un job ailleurs, si la justice interpersonnelle et informationnelle n’est pas pratiquée. C’est d’ailleurs, sur ces points-là que des entreprises perdent leurs meilleurs talents.
Dans votre livre, vous donnez des outils pour mesurer le sentiment de justice ou d’injustice au travail, avec un test notamment. Pourquoi ce test ? N’est-on pas capable de mesurer ce sentiment tout seul ?
Ce test est avant tout là pour aider chaque lecteur, manager ou salarié, à mieux se comprendre lui-même, à mieux évaluer les différentes dimensions de ce sentiment d’injustice, à mieux lire ses ressentis et ses émotions. Ça permet de mettre des mots sur ses ressentis et de repérer plus vite ce qui ne va pas.
Vous faites des formations sur cette thématique en entreprise. Comment se passent-elles concrètement et quel est leur objectif ?
Cela leur permet d’apprendre à mettre en place de nouvelles méthodes de management qui soient plus justes à tous les étages que nous avons évoqués. On met en place ensemble, avec eux, des programmes pour transformer leurs comportements. On ne va pas changer leurs valeurs, mais leur façon de faire. Cela passe par de l’expérimentation. On leur fait vivre les différentes situations et les comportements adaptés à mettre en place, grâce à des exercices in situ avec leurs propres équipes. En suggérant de faire autrement, on donne des méthodes qui permettent d’adapter les comportements de façon réelle et concrète, et d’en voir très rapidement les bénéfices au quotidien dans l’entreprise.
Quels outils leur proposez-vous ?
Plusieurs outils fonctionnent très bien avec les top managers, comme « la méthode des processus délégués », qui permet de passer d’un management autoritaire et directif à un management non seulement participatif mais surtout délégatif. Dans cette méthode, au final, le patron ne dit plus rien et c’est l’ensemble de son équipe qui prend la décision. Quand on commence à l’appliquer en partant du sommet de l’entreprise, c’est-à-dire du comité de direction, en général ensuite il y a contagion, et on peut ainsi l’appliquer avec les directeurs, puis les managers intermédiaires, puis les chefs d’équipes, les chefs d’ateliers.
Un autre outil marche très bien, c’est celui qu’on appelle « le manager coach ». Le manager apprend à manager ses équipes en ne leur expliquant plus ce qu’il faut faire mais en leur posant des questions. Cela part d’études neuroscientifiques qui démontrent qu’un cerveau à qui l’on donne un ordre ne réagit pas, c’est un cerveau plat. En revanche, un cerveau à qui l’on pose une question devient un cerveau actif. Cette méthode du management par les questions donne d’excellents résultats très concrets.
Votre précédent livre s’intitulait « le meilleur coach, c’est vous ». Pourtant, on voit bien que de nombreux dirigeants ont besoin de coachs extérieurs, notamment en matière de management ?
En fait, il faut surtout faire la part des choses entre les consultants qui sont des formateurs en management, et ceux qui se prennent pour des gourous avec des accompagnements au long cours. Le danger pour un dirigeant, c’est de faire confiance à des « gourous » ou soit-disant experts qui vous disent quoi faire. Méfiez-vous des experts !
Je crois plus aux consultants et aux personnes qui sont là pour vous permettre de vous connecter à vos propres ressources internes. Un dirigeant ou un manager peut avoir besoin de l’aide temporaire d’un coach pour cela, pour l’aider à mettre en place de bons outils, au cours de séminaires, de formations de quelques heures. En revanche, s’entourer d’experts pour un accompagnement au long cours, c’est un contresens.
Vous définissez une personne « épanouie » au travers de trois mots « Action, Relation, Vision ». Peut-on définir un manager épanoui avec ces trois mêmes mots ?
Oui, parce qu’un manager est une personne au travail dans une organisation. Si un manager a développé suffisamment sa connaissance de lui-même, ses propres ressources, son propre optimisme, alors il aura déjà bien avancé sur le chemin de l’épanouissement personnel. Il aura nettoyé ses lunettes avant de voir ailleurs !
Et s’il sait aligner ses forces personnelles avec les valeurs de l’entreprise et au travers de relations coopératives et bienveillantes avec les autres, alors oui, on pourra parler de manager épanoui. Car ce sont à la fois les sentiments de justice et d’épanouissement qui permettent de mobiliser les énergies dans l’entreprise.
Quel message avez-vous envie de faire passer en conclusion à tous les managers qui liront cet entretien ?
Le temps est venu pour que la voix intérieure des salariés remplace la voix extérieure des managers. Un management plus juste et des relations plus humanistes sont les clés d’une meilleure réussite du travail collectif.
Propos recueillis par Valérie Loctin